Pour plus d’informations
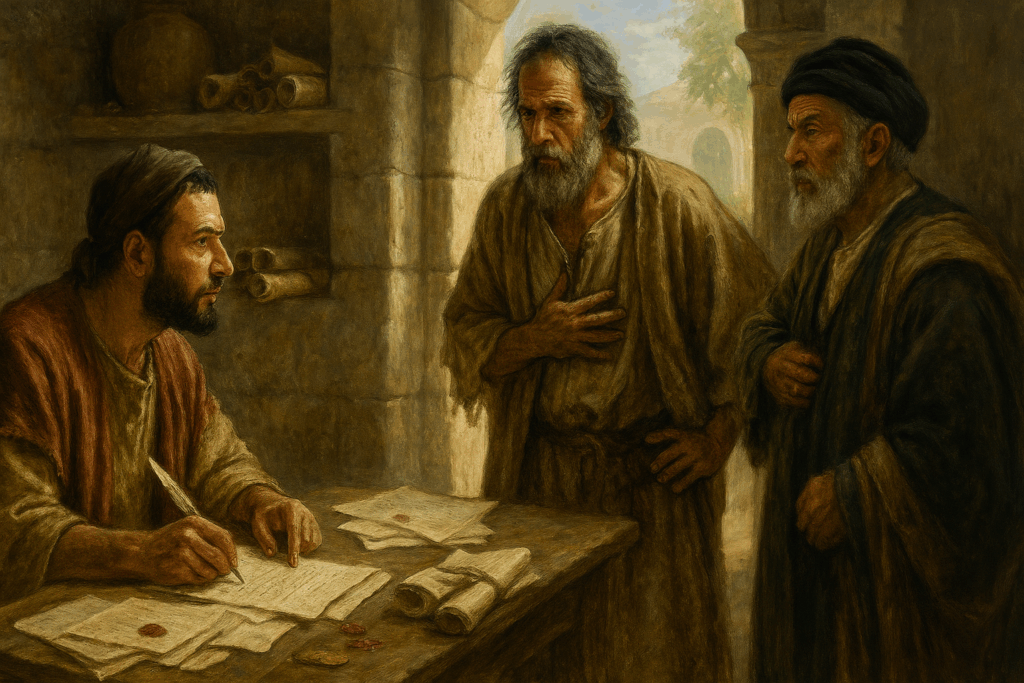
Textes bibliques
Résumé de la parabole
Dans Luc 16.1-9, le Messie Jésus raconte la parabole du gérant infidèle. Un homme riche a un gérant qui est accusé de gaspiller ses biens. Le maître appelle le gérant et lui demande de rendre compte de sa gestion, car il ne pourra plus gérer ses affaires.
Le gérant, sachant qu’il va perdre son emploi, réfléchit à un plan pour s’assurer un avenir. Il appelle les débiteurs de son maître un par un et réduit leurs dettes. À celui qui devait cent mesures d’huile, il dit d’écrire cinquante. À celui qui devait cent mesures de blé, il dit d’écrire quatre-vingts.
Le maître loue le gérant infidèle pour sa prudence, bien qu’il ait été malhonnête. Jésus conclut en disant que les enfants de ce monde sont plus avisés dans leurs affaires que les enfants de lumière. Il exhorte ses auditeurs à se faire des amis avec les richesses injustes afin que, lorsqu’elles feront défaut, ils soient accueillis dans les demeures éternelles.
Le contexte du discours
Le contexte immédiat et narratif de
Contexte narratif dans l’Évangile de Luc
La parabole de l’économe infidèle est proclamée juste après celle du fils prodigue (
Les disciples (Luc 16.1) : c’est à eux que cette parabole est directement adressée.
Les pharisiens (Luc 16.14), qui entendent et réagissent à l’enseignement, notamment sur l’argent.
Les chapitres de Luc 15 et 16 forment un diptyque :
Luc 15 montre la miséricorde divine envers les pécheurs.
Luc 16 introduit une réflexion sur la gestion des biens terrestres, la fidélité, et la sagesse dans l’attente du Royaume.
Contexte théologique et littéraire
La parabole est placée dans une section où Luc développe :
La tension entre richesse et Royaume : Jésus oppose les “fils de ce monde” aux “fils de lumière”.
La sagesse pratique : L’intendant est loué non pour sa malhonnêteté, mais pour sa prévoyance et sa capacité à se projeter dans l’avenir.
La fidélité dans les petites choses : Jésus enchaîne avec des maximes sur la gestion, la confiance, et le service de Dieu ou de Mammon.
Enjeux spirituels du contexte
Le Messie Jésus semble vouloir :
Secouer les disciples sur leur rapport à l’argent et à la responsabilité.
Montrer que même les gens du monde savent anticiper, et que les croyants doivent faire preuve d’une sagesse encore plus grande pour les biens éternels.
Préparer l’auditoire à la parabole du riche et de Lazare (
Thème
Le thème central de la parabole de l’économe infidèle (
Thèmes principaux
Prévoyance et habileté dans l’urgence : L’économe, sur le point d’être renvoyé, agit avec ruse pour se faire des alliés. Le Messie Jésus ne loue pas sa malhonnêteté, mais son intelligence stratégique.
Le message : les enfants de lumière devraient être aussi avisés dans les choses du Royaume que les enfants du monde dans les affaires terrestres.
Usage des richesses injustes
Jésus invite à se faire des amis avec l’argent, non pour corrompre, mais pour investir dans des relations durables qui mènent aux “demeures éternelles”.
L’argent devient un outil de service, non une fin en soi.
Fidélité dans les petites choses
La parabole est suivie d’enseignements sur la fidélité : celui qui est fidèle dans peu l’est aussi dans beaucoup.
Elle pose la question : Comment Dieu pourrait-il confier les vraies richesses à ceux qui gèrent mal les biens terrestres ?
Choix entre Dieu et Mammon
La conclusion est claire : “Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent.”
Le disciple est appelé à un choix radical entre deux maîtres.
En résumé
Cette parabole enseigne que la manière dont nous gérons les biens matériels révèle notre disposition spirituelle. Elle appelle à une sagesse active, une fidélité concrète, et une vision eschatologique : utiliser les ressources présentes pour préparer l’avenir éternel.
Description de la Parabole
Voici une description détaillée et verset par verset de la parabole de l’économe infidèle selon
Cette parabole, bien que déroutante à première lecture, invite à une sagesse active, à une gestion avisée des ressources, et à une vision eschatologique. Elle ne justifie pas la fraude, mais elle valorise la capacité à anticiper, à se projeter, et à agir avec discernement dans l’urgence.
Analyse du verset de Luc 16.9
Ce verset de
Le verset :
« Et moi, je vous dis : Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu’ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu’elles viendront à vous manquer. »
« Faites-vous des amis avec les richesses injustes »
Richesses injustes (en grec mamōna tēs adikias) : Ce terme ne désigne pas nécessairement de l’argent acquis par fraude, mais plutôt les biens matériels dans un monde marqué par l’injustice. Jésus reconnaît que l’argent est souvent lié à des systèmes imparfaits, mais il ne rejette pas son usage : il appelle à le sanctifier par l’usage.
Faites-vous des amis : Cela signifie : utilisez vos ressources pour créer des liens durables, pour aider, pour être généreux. L’argent devient un instrument de charité, de solidarité, et de communion.
« Afin qu’ils vous accueillent dans les habitations éternelles »
Ils : Interprétation ouverte. Il peut s’agir : des amis que vous avez aidés, qui vous accueilleront dans le Royaume.
Ou de manière plus théologique, Dieu lui-même, ou les anges, qui reconnaissent l’usage juste des biens.
Habitations éternelles : Image du Royaume de Dieu, de la vie éternelle, de la communion avec Dieu. Jésus suggère que l’usage des biens terrestres a une portée eschatologique : il prépare l’entrée dans la vraie demeure.
« Lorsqu’elles viendront à vous manquer »
Les richesses ne durent pas. Elles sont transitoires, fragiles, et ne suivent pas dans la mort. Jésus invite à anticiper ce moment : à investir dans ce qui demeure quand l’argent disparaît.
En résumé
Ce verset enseigne que : les biens matériels, bien que imparfaits, peuvent être mis au service du Royaume.
Le disciple est appelé à une générosité stratégique, une charité prévoyante.
Ce qui est éphémère peut devenir une semence d’éternité, si elle est utilisée avec sagesse et compassion.
Signification de la parabole
Historiquement, cette parabole a suscité des interprétations variées en raison de la louange du gérant malhonnête. Elle est racontée dans le contexte des enseignements du Messie Jésus sur l’utilisation des richesses et la fidélité dans les affaires terrestres.
Les points clés de la signification incluent :
Prudence et Préparation : La parabole met en avant la prudence et la prévoyance du gérant, qui utilise une situation difficile pour se préparer un avenir sécurisé. Cette qualité de prévoyance est louée même si elle est utilisée de manière malhonnête.
Usage des Richesses : le Messie Jésus enseigne l’importance d’utiliser les richesses terrestres de manière avisée pour des buts spirituels et éternels. Les « richesses injustes » peuvent être utilisées pour faire du bien et se préparer un accueil éternel.
Contraste entre les enfants de ce monde et les enfants de lumière : La parabole souligne que les enfants de ce monde sont souvent plus habiles et prévoyants dans leurs affaires que les enfants de lumière, incitant ces derniers à agir avec plus de sagesse et de discernement.
Conclusion
La parabole du gérant infidèle dans Luc 16.1-9 enseigne des leçons complexes sur la prudence, l’usage des richesses et la préparation spirituelle. Le Messie Jésus utilise l’exemple d’un gérant malhonnête pour souligner l’importance de la prévoyance et de l’usage avisé des biens terrestres pour des objectifs éternels.
Bien que le gérant soit loué pour sa prudence plutôt que pour son honnêteté, la parabole incite les disciples à utiliser les ressources à leur disposition pour se préparer un avenir spirituel sécurisé. Cette parabole appelle à une gestion sage et fidèle des ressources terrestres, en vue des valeurs du Royaume de Dieu.
Reprise de ce thème
Le thème de la parabole de l’économe infidèle, à savoir la gestion avisée des biens terrestres en vue des réalités éternelles, est repris et développé ailleurs dans la Bible, parfois sous des formes plus explicites, parfois en filigrane. Voici les principaux passages qui prolongent ou éclairent ce thème :
Dans l’Évangile de Luc lui-même
Un homme accumule des biens sans se soucier de son âme ni de l’avenir éternel. Dieu l’interpelle : « Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera redemandée. »
Thème commun : l’urgence de penser à l’au-delà, et non seulement à la sécurité matérielle.
Juste après l’économe infidèle, cette parabole montre un riche qui ignore le pauvre à sa porte. Après la mort, les rôles sont inversés.
Thème commun : les conséquences éternelles de l’usage des biens et de l’indifférence sociale.
Chaque serviteur reçoit une somme à gérer pendant l’absence du maître. À son retour, il récompense la fidélité et sanctionne l’inaction.
Thème commun : la responsabilité dans la gestion des ressources confiées.
Dans les autres évangiles
Jésus enseigne : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre… Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »
Thème commun : le choix entre Dieu et Mammon, et la nécessité de viser les biens célestes.
Les serviteurs doivent faire fructifier les dons reçus. Le maître récompense ceux qui ont agi avec sagesse.
Thème commun : l’investissement spirituel à partir des ressources terrestres.
Dans les épîtres
Paul parle des apôtres comme des intendants des mystères de Dieu, et insiste : « Ce qu’on demande à des intendants, c’est qu’ils soient trouvés fidèles. »
Thème commun : la fidélité dans la mission confiée, qu’elle soit matérielle ou spirituelle.
Paul exhorte les riches à être généreux : « Qu’ils amassent ainsi pour eux-mêmes un trésor placé sur une base solide pour l’avenir. »
Thème commun : l’usage des richesses comme semence pour la vie éternelle.
Synthèse spirituelle
La parabole de
Les biens terrestres sont provisoires, mais leur usage a des conséquences éternelles.
Le croyant est appelé à une sagesse active, une fidélité concrète, et une vision eschatologique.
Dieu confie des ressources, matérielles, spirituelles, relationnelles, et attend qu’elles soient mises au service du Royaume.
Paraboles paradoxales dans les Evangiles
Il existe plusieurs paraboles paradoxales dans les évangiles, des récits où Jésus utilise des personnages ou des situations inattendues, parfois choquantes, pour transmettre une vérité spirituelle profonde. La parabole de l’économe infidèle (
Voici quelques autres paraboles qui partagent ce caractère paradoxal :
Les ouvriers de la dernière heure (
Des ouvriers embauchés à différentes heures reçoivent tous le même salaire.
Paradoxe : ceux qui ont travaillé le moins sont payés autant que les premiers.
Leçon : la grâce divine ne se mesure pas à la durée du service, mais à la générosité du maître.
Le trésor caché et la perle de grand prix (
Un homme vend tout ce qu’il possède pour acheter un champ ou une perle.
Paradoxe : tout perdre pour une chose invisible ou minuscule.
Leçon : le Royaume de Dieu vaut le sacrifice total, même s’il semble irrationnel.
La brebis perdue et la pièce perdue (
Le berger laisse 99 brebis pour chercher une seule ; la femme retourne sa maison pour une pièce.
Paradoxe : l’attention extrême portée à ce qui est perdu, au détriment du reste.
Leçon : Dieu se réjouit plus pour un pécheur qui revient que pour ceux qui n’ont pas besoin de conversion.
Le fils prodigue (
Le fils rebelle est accueilli avec fête, tandis que le fils fidèle est troublé.
Paradoxe : le repentir du fautif est célébré plus que la fidélité du juste.
Leçon : la miséricorde divine dépasse les logiques humaines de mérite.
Les vignerons homicides (
Des vignerons tuent les envoyés du maître, puis son fils.
Paradoxe : le maître semble patient à l’excès, et les meurtriers héritent du jugement.
Leçon : Israël rejette les prophètes et le Fils, mais le Royaume sera donné à d’autres.
Pourquoi ces paradoxes ?
Jésus utilise le paradoxe pour : renverser les attentes religieuses et sociales, provoquer la réflexion et la remise en question, révéler la logique du Royaume, souvent opposée à celle du monde
Ce principe suscite l’intérêt des auditeurs et des lecteurs, qui sont interpellés par cette approche de présentation.
Commentaire
Cette parabole apparait surprenante car elle semble mettre en exergue un comportement malhonnête qui ne cadre pas avec l’enseignement du Messie Jésus. En réalité, le Maître montre en exemple le comportement de cet homme qui agit avec intelligence pour préparer son avenir.
Ce paradoxe questionne les attentes morales habituelles. Alors que l’on pourrait s’attendre à une condamnation ferme de l’attitude du gérant, c’est au contraire sa capacité à anticiper et à agir avec sagacité qui est valorisée. Cette mise en avant du discernement, même chez un personnage faillible, invite à réfléchir sur la logique du Royaume, qui dépasse et bouscule les critères humains de mérite et de justice.
Les auditeurs du Messie Jésus ont certainement été bouleversés par cet enseignement, tant le paradoxe évoqué a marqué les esprits. Ce message interroge profondément sur la notion de « richesses injustes », qui ne se limite pas à la seule question de l’argent. En effet, cette appellation englobe également les capacités personnelles de chacun, invitant à les considérer comme des ressources à mettre au service d’autrui.
Il convient donc, à la lumière de ce paradoxe, d’utiliser ses talents et ses aptitudes pour aider, encourager et accompagner son prochain. L’homme n’aura pas à rendre compte des dons ou des talents qu’il a reçus de façon injuste dès la naissance, mais il devra en revanche rendre compte de l’usage qu’il en aura fait tout au long de sa vie (Matthieu 25.14-30 et Luc 19.11-27).
En réalité, tout ce que l’homme possède ne lui revient pas de droit, mais provient d’une injustice originelle, comme l’affirme l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4.7 : nul ne peut se glorifier de ses biens, car tout lui a été donné. Dès lors, il est invité à adopter l’attitude de l’économe infidèle de la parabole, car il partage avec lui cette condition d’avoir reçu sans mérite propre.
Cette perspective invite chacun à reconnaître que toutes ses possessions, ses talents et ses aptitudes doivent être considérés non comme des biens personnels à défendre, mais comme des ressources à employer avec discernement et générosité au service d’autrui. Ainsi, loin de condamner l’intelligence et la ruse mises en œuvre par l’économe, la parabole valorise sa capacité à anticiper et à agir pour préparer l’avenir, montrant que la logique du Royaume de Dieu dépasse les critères humains habituels de justice et de mérite.
Conclusion
La parabole du gérant malhonnête (
Les « richesses injustes » évoquées ne désignent pas seulement l’argent, mais tout ce que l’on possède sans mérite : talents, opportunités, savoirs, réseaux. Ces biens, reçus selon des circonstances indépendantes de nous, deviennent des moyens à investir pour le bien d’autrui. L’Évangile ne glorifie ni la ruse ni la richesse, mais l’usage intelligent et généreux de ce qui nous est confié.
Ainsi, cette parabole nous exhorte à une gestion responsable de nos ressources, en vue de l’avenir véritable : celui du Royaume des cieux. Le disciple est appelé à orienter ses choix non vers la sécurité terrestre, mais vers une fécondité spirituelle. Ce qui compte, ce n’est pas ce que l’on possède, mais ce que l’on prépare, pour soi et pour les autres, dans la lumière de l’éternité.

